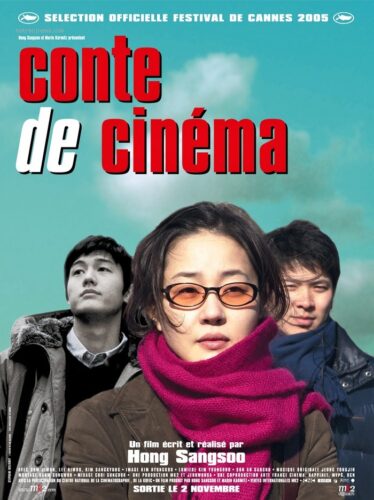De Hong Sang-Soo, on sait qu’il est un des rares auteurs récents à avoir renouvelé le champ d’un cinéma asiatique rivé à ses réflexes de modernité selon divers axes (durée, silence, construction narrative) devenus marques de fabrique orientale. Chez lui, parole et nonchalance contrôlée, une certaine indolence prennent le contrôle des cadres en un retour de réel à la singularité absolue. La part la plus bouleversante de Conte de cinéma tient probablement à sa manière de porter à incandescence cette langueur stylistique sans pour autant, à aucun instant, témoigner du moindre essoufflement de la part d’un cinéaste dont la simplicité, justement, pourrait aisément faire suspecter une tendance à tourner en rond (rumeurs cannoises). Rien de plus dangereux pourtant que ce genre de récit en miroirs, première partie « fiction » (un film dans le film) et seconde partie « réel » (l’actrice du film dans le film censée retrouver la réalité), soit un aspect parabole et réflexion sur le cinéma assez artificiel en surface.
D’une certaine manière, Conte de cinéma tire sa force d’une qualité équivalente à celle de l’autre grand film de la semaine (et de l’année bien sûr), A History of violence de Cronenberg : chacun dure à peine plus d’une heure trente et joue d’une modestie et d’une sensibilité qui, à partir d’un matériau a priori banal, se transcendent en une sorte de superpouvoir originel de mise en scène. La douceur et l’exceptionnelle finesse avec laquelle Hong Sang-Soo traite son personnage féminin principal, étudiante suicidaire ou starlette éplorée par la maladie de son mentor, tient en quelques lignes : scènes qui se dédoublent pour trouver résolution dans une étreinte sublime (avec le réalisateur raté, dans la seconde partie), filmage anodin d’un détail qui grossit à mesure que le film progresse (une ruelle, un aspect du décor urbain), sens de la suspension guidant chacun des personnages en un cheminement musical et gracieux qui ne se départit jamais de sa puissance d’évocation réaliste. La maîtrise du temps est l’autre grande force de Hong Sang-soo, capable de moduler sur quelques jours une infinité d’histoires potentielles : la multiplicité des personnages du repas des techniciens, au cœur du film, où chacun existe le temps de quelques minutes ou échange de paroles, en est le plus bel exemple.
Autre prodige, une virtuosité à passer du glauque à l’enchanté qui tient dans les dispositifs les plus simples : l’utilisation du zoom et du recadrage par exemple, honnie par la sophistication, trouve ici une forme quasi-rituelle, ré-enclenchant constamment le sens profond des scènes (l’importance de la grande tour de Séoul notamment). Il y a là une manière de filmer l’espace urbain exceptionnellement poétique, dans ses lignes de pure intermittence (ruelles, trottoirs, fonds de bar ou de restaurant), le cœur du film se dessinant dans la marge ou les faubourgs de la fiction (ébriété et bavardages très rohmériens). Ceci est d’autant plus troublant que Hong a réalisé beaucoup de films ruraux ou provinciaux et que Séoul, malgré la vitalité du cinéma coréen, demeure une ville largement méconnue du paysage cinématographique. Dès lors, l’intimité et la sensualité avec laquelle apparaît la mégalopole n’est pas le moindre des charmes de ce film bouleversant.