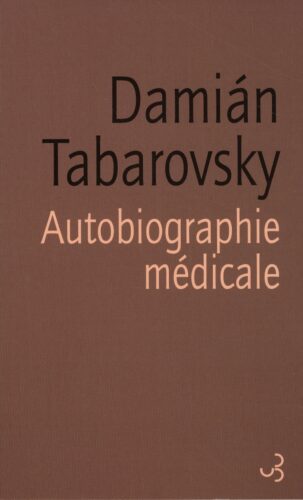Diplômé en sociologie de L’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, Damián Tabarovsky, né à Buenos Aires en 1967, a publié des essais, des romans et traduit des poètes et romanciers d’avant-garde. Il est aussi éditeur dans une des plus jeunes et plus inventives maisons d’édition de Buenos Aires. Rencontre, à l’occasion de la parution de son excellent nouveau récit tragi-comique Autobiographie médicale.
Singulier Tabarovsky. Presque aussi connu dans son Argentine natale pour son travail de journaliste, d’éditeur et de polémiste que pour son oeuvre littéraire, ce francophile aguerri (il a étudié à Paris et a traduit Supervielle et Louis-René des Forêts en argentin) refuse absolument de séparer son amour de la théorie (sociologie, psychanalyse, structuralisme et post-structuralisme etc.) de sa passion pour la littérature. Récits d’idées et de pensées mais jamais d’opinions, ses romans « post-flaubertiens » et deleuziens en diable auscultent, désossent, déconstruisent les paradoxes de la psyché humaine aussi bien que ceux du monde contemporain (argentin, et plus si affinités). Ainsi, le protagoniste de son nouveau récit, Autobiographie médicale, ne cesse de rater le coche de la réussite professionnelle et sociale à cause de maladies intempestives survenant toujours à l’avant-dernier échelon de l’ascension. S’agit-il pour autant d’un roman moral, ou d’un roman d’apprentissage ? Heureusement pour la littérature, ni l’un, ni l’autre : à l’instar de ses personnages hébétés par le sort, le lecteur de Tabarovsky n’apprend rien. Tout au plus, il palpite, s’enivre de la brillance des analyses qui s’amoncellent et se contredisent, et se bidonne. Rencontre (en français) avec un amoureux du paradoxe, lui-même belle personne ambiguë.
Chronic’art : Au début de Autobiographie médicale, vous partez d’un paradoxe tout simple (le protagoniste du roman se rend à un examen pour passer son permis de conduire en voiture) pour évoquer le syllogisme, cette étrange règle de trois de la logique. C’est un bon point de départ pour résumer le projet du livre ?
Damian Tabarovsky : Dami, comme la plupart des personnages de mes romans, essaye de comprendre le monde. Mais ce qui m’intéresse le plus, ce sont les répercussions dans son esprit. J’écris des romans mentaux. Les personnages d’Autobiographie médicale ne sont pas Dami ou ses collègues, ce sont ses idées. Un autre personnage est le narrateur qui évoque ces idées. Bien sûr, c’est un jeu paradoxal, et le roman commence sur des phrases paradoxales : « C’était un après-midi venteux, très venteux. Il ne coulait pas une goutte d’air ». Aussi, le roman s’intitule Autobiographie médicale, mais il est écrit à la troisième personne. Et il suit un modèle de progression par la répétition, pour interroger le principe même de progrès. Il n’y a aucun développement, aucune action. Ma référence au syllogisme est ironique : plus on essaye de comprendre, plus on se perd. Dami ne comprend rien. Entre les lignes, il faut lire un commentaire sur la littérature contemporaine, et sur la division des formes. Dans ce récit qui n’est pas tout à fait un roman, il y a des éléments du roman. Mais aussi de l’autobiographie, de critique littéraire, de la satire. C’est très contemporain.
Vous avez étudié la sociologie et les sciences du langage, notamment à l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, il y a plus de vingt ans. Comment les idées et les jargons ont-ils trouvé leur place dans votre littérature ?
C’est un de mes socles. Mais dès mon retour en Argentine, je suis devenu journaliste et éditeur. Parce que je ne voulais pas devenir un « intellectuel », pour utiliser un gros mot. J’ai le savoir, je refuse l’habit. Dans ma bibliothèque privée, il y a une moitié d’ouvrages de littérature, et une moitié d’essais. Ces deux mondes co-existent à égalité dans ma tête. Et dans mes œuvres : les personnages et les idées travaillent main dans la main. Je souhaite que mes romans continuent après le point final.
Dans Autobiographie médicale, il y a une véritable dichotomie, presque intellectuelle, qui s’exprime entre le narrateur, qui ergote et théorise, et le personnage de Dami, qu’on sait incapable d’avoir ces idées…
Mon roman favori est Bouvard et Pécuchet, le roman qui tourne en rond par excellence. Mes livres sont post-flaubertiens, mais pas parce que mes personnages sont parfois des idiots : plutôt parce que l’esprit du narrateur et ceux les personnages s’entremêlent. Ceci dit, le narrateur est moins distant dans mes romans que dans ceux de Flaubert : parfois, il intervient directement.
Au-dessus du narrateur, il existe une troisième voix, qui est muette mais semble mettre en doute ses théories. C’est la vôtre ?
Ca dépend. C’est plus complexe. Elle prend la parole à la fin d’Autobiographie médicale et de mon roman précédent, L’Expectative. Mais on ne sait pas d’où elle vient. Elle discourt et théorise anonymement. C’est cette fameuse « voix venue d’ailleurs » analysée par Louis-René des Forêts, que j’ai traduit en espagnol. Pour Maurice Blanchot, c’est la voix de Dieu. Pas pour moi : ça serait plutôt la voix du néant, qui prend tout à la rigolade, qui soupçonne tout, et qui démultiplie le sens de tout ce qui est écrit. La seule conclusion d’Autobiographie médicale, c’est que la maladie existe, qu’elle fait sens, mais qu’elle n’est métaphore de rien. Son sens est polysémique.
Plus précisément, vous écrivez que la maladie n’est la métaphore de rien à part d’elle-même. La maladie en tant que telle (quand elle n’est ni imaginaire, ni une métaphore de la littérature) est rarement évoquée dans la littérature…
Il y a le modèle de Jünger, que je trouve un peu fasciste, et qui voit la maladie comme une épreuve dont on doit sortir plus fort. Pour moi, on en sort plus faible. Il y a un autre modèle qui dit que la maladie est un éclair de normalité. En réalité, la maladie ne sert à rien. Et elle est intéressante précisément pour cette inutilité : elle est inutile dans un monde où tout sert à quelque chose. Ou plutôt, elle ne sert qu’à forcer le dilettantisme. C’est une anomalie qui n’apprend rien, une incarnation d’inefficacité. Si elle est métaphore, ce n’est pas du capitalisme mais de son contraire. Si elle est métaphore de la littérature, c’est d’une forme d’art inutile. Je défends cette idée d’une littérature inutile.
Vous avez pourtant écrit La Littérature de gauche (inédit en français¸ ndlr), dans lequel vous exhortez les auteurs à s’engager…
C’est tout le contraire. Ce dont je parle dans ce livre (qui vient d’ailleurs de paraître en Espagne) c’est de ces auteurs politiquement à gauche, dont les livres sont formellement conservateurs, pédagogiques, réalistes dans le sens le plus banal du terme. Dans le cas des Argentins, ce sont des victimes des dictatures, engagés dans la liberté et les droits de l’homme, qui se félicitent qu’on vende leurs livres en usant des mêmes campagnes publicitaires que pour la lessive ou les ordinateurs, et qui pensent que rien n’est grave tant que l’intention est de faire « lire » les gens. D’un point de vue littéraire, ils sont réactionnaires. J’ai l’espoir de voir émerger une nouvelle littérature de gauche par la syntaxe et le langage, qui interrogerait les langages hégémoniques des médias, des sports, de la politique et de la santé. Ces quatre modes d’expression-là fonctionnent ensemble et tiennent en otage tout le débats nationaux par leurs schémas : le fait qu’il y ait des vainqueurs et des vaincus, des winners et des losers. Une vraie littérature de gauche doit être aussi inutile que la maladie. Mon livre est sorti dans plusieurs pays d’Amérique latine et en Espagne et a provoqué beaucoup de polémiques.
D’après ce que j’en sais, la France n’est pas exempte de ce phénomène, et vous avez beaucoup d’écrivains qui se revendiquent à gauche mais qui sont en réalité des « écrivains du marché ».
Les artistes engagés à gauche sont toujours déchirés entre la volonté de recherche (l’avant-garde loin des préoccupations populaires) et la volonté pédagogique pour parler au plus grand nombre… Cela me rappelle le retournement de veste du compositeur Cornelius Cardew, qui a commencé dans l’avant-garde la plus hermétique pour devenir maoïste et écrire un livre contre son ancien maître, Stockhausen (Stockhausen serves Imperialism). La musique qu’il écrivait à la fin de sa vie était tonale et très belle, puisqu’elle s’inspirait de Bach et de chansons traditionnelles irlandaises, mais aussi étrangement désuète et réactionnaire…
Quand Stockhausen composait pour un quatuor dans quatre hélicoptères (le fameux Helikopter-Streichquartett, ndlr) il exprimait quelque chose d’antisocial, de très négatif : il ne pouvait pas être Wagner, mais il revendiquait son droit à raconter qu’il ne pouvait pas être Wagner. Ca rentre précisément dans ma définition. Et mes romans racontent quelque chose de similaire : ils racontent leur droit à ne pas raconter une histoire.
Votre littérature incarne donc littéralement le résultat de votre cheminement théorique ?
Je dirais intellectuel plutôt que théorique, mais oui. Bien entendu, mon souhait n’est pas d’écrire des livres didactiques, moralisateurs. Mais je défends absolument le terme de « livre intellectuel ». Je n’ai pas à m’excuser.
Le philosophe allemand Peter Sloterdijk déplore souvent qu’on n’invite plus les intellectuels à la télévision pour venir parler des sujets complexes.
C’est un débat confus. Est-ce qu’il faut se battre pour aller parler dans des émissions avilissantes, en espérant remonter le niveau des débats ? Je ne sais pas. Les débats publics ne concernent plus vraiment personne. En français, vous avez une catégorie que j’aime beaucoup : « classe médiatico-politique »… Un monde fermé qui n’évoquerait que des problèmes qui ne le concernent que lui. Avant, j’avais tendance à penser qu’il fallait le prendre avec humour et ironie. En fait, je crois qu’il faut le prendre très au sérieux : il définit l’horizon de l’époque. La littérature à quelque chose à dire là-dessus. André Agassi, le tennisman, était connu pour sa capacité à utiliser la force de frappe de son adversaire en contrecoup. Plus les médias frappent fort, plus ma littérature est affûtée.
Est-ce pour cette raison que vous avez choisi pour héros d’Autobiographie médicale un individualiste dénué de toute idéologie politique, qui ne comprend rien de ce qui lui arrive ?
Il ne comprend rien de ce qui lui arrive, effectivement, mais il est bien habité par une idéologie : celle de la réussite. C’est une des questions du livre : qu’est-ce que la réussite ? Qu’est-ce que l’échec ? Bien entendu, je n’ai pas de réponse, et le livre non plus.
Pourquoi avoir appelé le personnage comme vous ?
Ma femme et mes amis m’appellent effectivement « Dami ». Mais je crois que c’était, comme l’idée d’une autobiographie à la troisième personne, une manigance pour ne pas écrire à la première, comme tant de romans et tant de publicités. Cette voix qui dit « moi, j’utilise ce shampooing », elle est insupportablement sûre d’elle-même, satisfaite, pleine et assurée. Dami est un alter ego, et je suis loin d’être au-dessus de tout soupçon. Il est trop facile de se moquer du monde entier sans s’inclure dans la satire. J’ai eu certaines des maladies dont souffre Dami dans le livre, et j’ai également travaillé comme enquêteur dans une boîte de sondage quand j’étais étudiant ; il y a donc une partie de vécu dans le livre.
Avoir recours au savoir théorique pour vendre mieux et manipuler plus, c’est une forme de Mal de notre temps ?
Je refuse les notions aussi morales que celles de Bien et de Mal, mais les sondages, par exemple, sont certainement une forme de contrôle social. Tout le monde le sait, mais on ne le répète jamais assez, on ne s’en indigne jamais assez : parce qu’au fond, ça ne nous dérange pas plus que ça.
De même pour la littérature, et la manière dont elle nous est vendue ?
Il y a une tension entre les livres et la littérature. Les livres, c’est la couverture et le prix de vente. La littérature, c’est la névrose, l’insomnie. L’écrivain doit passer par les livres, mais il y a trop d’écrivains de livres, pas assez d’écrivains tout court. Par exemple, je refuse d’emblée l’idée de prix littéraires. Il y a déjà trop de gagnants et de perdants : de ce point de vue, moi-même, je suis un perdant par rapport à des auteurs de best-sellers, et un gagnant par rapport à tous les auteurs non publiés, mais est-ce que je me positionne ainsi dans la société ? J’attends plus de la littérature. Une manière inédite de voir le monde, pour commencer. C’est un peu cliché, mais j’attends toujours.
C’est en contradiction avec votre idéal d’une littérature inutile…
C’est un éternel paradoxe de ma littérature : raconter l’histoire que toute tentative de raconter une histoire est vaine. Je ne sais pas qui perd à la fin. Ne servir à rien équivaut à servir à quelque chose.
A bien des égards, vous êtes un classique.
Il y a de ça dans toute la littérature argentine : elle a énormément de points similaires avec la littérature européenne, mais elle n’est jamais tout à fait comme elle. Il y a toujours un atome défectueux, un grain de sable dans la machine qui la fait déraisonner. Comme chez Borges. J’essaye d’approfondir cette tradition classique et excentrique à la fois. Je m’y sens comme un poisson dans l’eau.
Borges, comme Rodrigo Fresàn, ne se considère pas comme un « auteur argentin »…
Il n’y a pas une seule tradition argentine, mais beaucoup de courants différents. Fresàn est particulier : il a vécu dans trois pays différents dont l’Espagne. Borges disait que la tradition argentine de la littérature était la littérature du monde. Je dois dire que je ne suis pas tout à fait d’accord : je me sens le continuateur d’une tradition très essentiellement argentine, celle de l’excentrisme, de la marge : César Aira, Fogwill qui vient de mourir, Copi (même s’il écrivait en français). Ils écrivent tous sur l’Argentine, mais jamais de manière centrale. Comme moi. D’une certaine manière, Autobiographie médicale est un livre sur Buenos Aires.
C’est cette tradition que vous souhaitiez différente à l’époque où vous étiez éditeur chez Interzona ?
J’ai publié beaucoup de choses différentes, y compris certains ouvrages de cette « littérature de témoignage » qui est encore très populaire en Argentine (la littérature de témoignage concerne tous les ouvrages évoquant les exactions des dictatures, ndlr), parce qu’ils s’intéressaient encore à la littérature, « malgré » leur sujet. Et des auteurs non-Argentins, comme le Mexicain Mario Bellatin, Christian Gailly ou Jules Supervielle. Mon intention avec cette collection était surtout de proposer un commentaire sur la littérature contemporaine, plutôt qu’une véritable alternative. Avec toujours, en horizon, la problématique au cœur de la littérature : qu’est-ce que ça veut dire, raconter une histoire ? A quoi ça sert ? Raconter une histoire est une tâche très complexe, et on ne peut pas éluder la problématique des mille et une stratégies pour le faire. La télévision raconte des histoires ; la politique et le sport aussi ; il est de la responsabilité de la littérature d’interroger les moyens. Au XIXe siècle, la compétition était entre la littérature de Balzac et la sociologie de Marx, Weber et Durkheim, et la littérature a dû devenir avant-gardiste et mettre le langage au cœur de ses préoccupations. Aujourd’hui, la compétition est entre la publicité et la philosophie, le marketing et la littérature. L’avant-garde du début du XXe siècle en tant que telle est morte, mais on ne peut faire autrement que de dialoguer avec son fantôme. Et la littérature doit s’imposer en négatif, et inventer des nouvelles manières de raconter des histoires parce que toutes les anciennes lui ont été volées.
Propos recueillis par Olivier Lamm